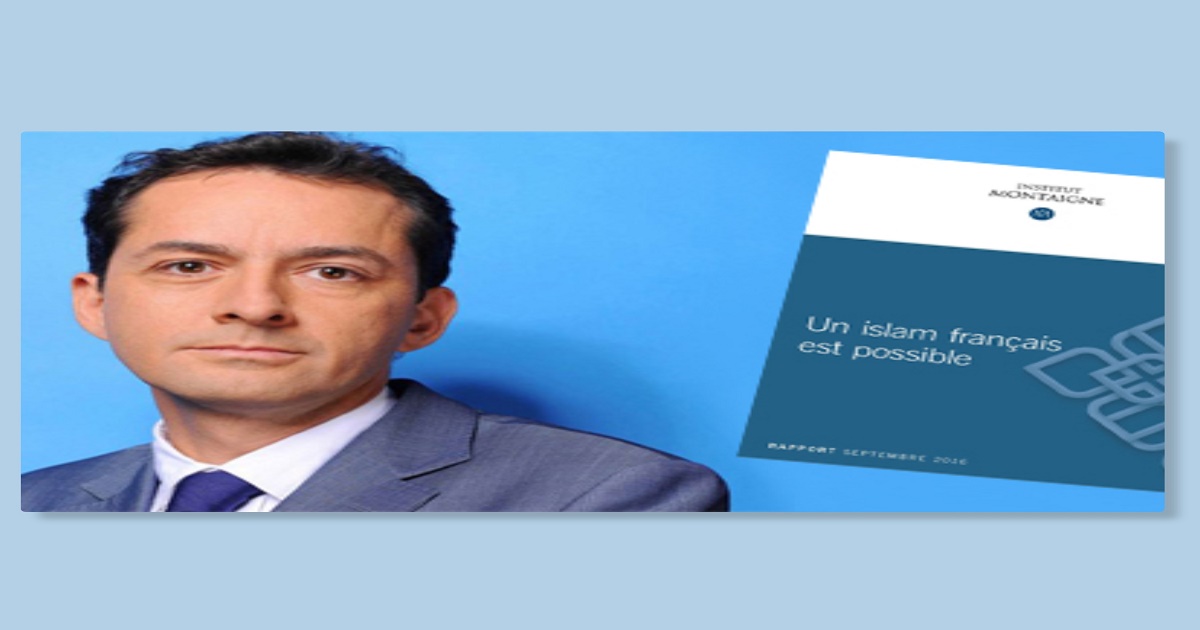
Si en matière d'"Islam de France", Hakim el Karoui échoue à proposer des orientations fonctionnelles c’est parce que, enfermé dans les limites étroites du politiquement correct, il se révèle parfaitement incapable de fournir une analyse crédible de son repoussoir "islamiste".
Il a déjà beaucoup été écrit sur le troisième rapport controversé présenté en septembre 2018 sous l’égide de l’Institut Montaigne par Hakim El Karoui (La Fabrique de l’islamisme), ex-conseiller du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin puis animateur avec Rachida Dati du Club xxie siècle et souvent présenté comme un conseiller écouté du président Emmanuel Macron sur les « affaires musulmanes »[1]. On se contentera donc ici de revenir sur le cœur de son dispositif analytique, à savoir son approche de l’«islamisme». Elle conditionne en effet à elle seule la validité de sa réflexion et, partant, l’efficacité de ses propositions sur le « devenir de l’islam de France ».
Un piètre digest du « politiquement correct » à la française
Dans un lapsus pathétique, qui résume toute l’ambiguïté de son entreprise, l’ex-directeur de l’Institut des cultures de l’islam a déclaré sur RTL vouloir proposer dans son rapport des mesures « pour lutter contre l’islam [2] ». Et de fait, sous sa plume, le profil du « bon musulman », le seul qui puisse espérer échapper à cette suspicion infamante de l’« islamisme » qui, de Abou Bakr al-Baghdadi – et on le suit volontiers – à la chanteuse Mennel Ibtissem – et on s’inquiète –, frapperait en France tant de ses coreligionnaires, ce « bon musulman », donc, semble bien être celui… « Qui n’est plus musulman ».
Dans ses propositions, tout n’est pas négatif, notamment l’importance accordée à un enseignement public de l’arabe, qui a suffi à déchaîner les réactions hystériques de toute la droite, pas seulement extrême, pourtant prête à se réjouir de bon nombre de ses autres suggestions.
L’appréciation du cœur de son dispositif analytique ne requiert en revanche que peu de nuances. La « montagne » des références académiques dont il éprouve très significativement le besoin de se parer (« plus de deux cents ») ne parvient pas à masquer la dimension réelle de la « souris » de ses conclusions : le rapport n’accouche en réalité que d’une paraphrase plate de ce sens commun qui fonde en la matière depuis des décennies le « politiquement correct » français.
S’il fallait ne mentionner qu’un exemple de l’indigence de cette prestation, ce serait son inventaire des facteurs identifiés comme étant à l’origine des succès électoraux des islamistes lors des printemps arabes.
La description de la relation entre religion et politique dans chacun des États du Maghreb et du Proche-Orient – une série d’affirmations gratuites et de clichés – échoue en effet à accéder au simple registre analytique : ces courants ont émergé, est-il expliqué, car ils ont été « portés par des sociétés de plus en plus conservatrices ». À cette évolution – pas le moindrement élucidée – s’ajoute seulement l’« effet également d’un salafisme importé d’Arabie saoudite ». Et l’auteur de conclure par cette interrogation d’une savante originalité : « Enfin, le djihadisme, la constitution d’un État islamique autoproclamé au sein de la région et la restauration du califat par ce dernier en 2014 continuent de poser la question du rapport entre pouvoir et religion. » Quels remèdes une telle « analyse » permet-elle d’entrevoir ?
Elle méconnait tout particulièrement cette dimension de « réaction à une overdose de présence occidentale » que génèrent à la fois les politiques « impériales » de l’Occident dans le monde musulman et, tout autant, les relais dictatoriaux sur lesquels – de l’Égyptien Abdel Fatah al-Sissi au Saoudien « MBS » (Mohammed ben Salmane) en passant par le Libyen Khalifa Haftar – il persiste à appuyer son influence. Elle prive donc le lecteur et, accessoirement, les destinataires officiels du rapport de toute opportunité d’en saisir véritablement les ressorts et les enjeux.
Avec l’assurance que donnent les raccourcis rhétoriques éculés propres à ce genre de prose, El Karoui prône l’ostracisation d’une importante composante de ses coreligionnaires français. Mais pour ce faire, il disqualifie tout autant des pans entiers de nos interlocuteurs du Sud musulman.
Il conforte ainsi le sens commun hexagonal, pour qui la couleur politique des vainqueurs des premières élections démocratiques du printemps arabe a très vite été considérée seulement comme la manifestation d’une pathologie inhérente à cette région. Et il entend donc imposer à l’ensemble des musulmans de France – sauf pour eux à être considérés comme entrant en dissidence républicaine – la rhétorique de criminalisation indistincte de l’entier spectre des courants islamistes (Frères musulmans inclus) : celle justement que, de Bachar el-Assad à Abdelfatah Sissi, les pires des dictateurs arabes rabâchent aujourd’hui pour justifier le soutien de leurs alliés occidentaux. Triste perspective…
En matière d’administration politique des citoyens musulmans, Hakim El Karoui, qui propose dans son rapport de faire appointer par l’État un « imam de France », dans la plus parfaite tradition coloniale [3], affiche ainsi le ton assuré du native informant qui «sait de quoi il parle ». Au lieu de s’associer moindrement aux courageux opposants de Ben Ali, n’a-t-il d’ailleurs pas fait partie, jusqu’à la dernière heure, de ceux qui ont désespérément essayé de lui permettre de sauver son trône [4] ?
Comprendre l’islamisme : deux thèses antagonistes
Il existe aujourd’hui deux grandes approches de cet « islamisme » contemporain, que l’on peut choisir de définir – a minima, tant ses expressions sont variées – comme étant, dans le monde musulman, l’usage en politique du lexique islamique. Le nouveau rapport d’El Karoui, comme les deux précédents (publiés en 2016 et 2017), s’inscrit tout entier dans la première des deux. Médiatiquement et politiquement triomphante, proche du sens commun, cette thèse est plus populaire dans les médias ou la classe politique que dans le monde académique – où elle est devenue, tout particulièrement chez les Anglo-Saxons, franchement minoritaire.
C’est celle selon laquelle, dans le droit fil d’une vision étriquée de l’expérience révolutionnaire française, la religion ne peut être en politique qu’exclusivement porteuse d’un potentiel totalitaire. Sa simple présence dans l’espace public sous l’une quelconque de ses formes – y compris le respect des rites alimentaires – serait antinomique avec la « laïcité » et ne pourrait nourrir qu’une dynamique de dérives sectaires et radicales. Pour cette thèse, nourrie par le courant emblématisé par l’Américain Bernard Lewis, l’unique réponse possible à l’« islamisme » contemporain consiste logiquement à rejeter, par tous les moyens, ses adeptes supposés hors des arènes politiques légitimes, nationales ou internationales.
Mais cette thèse occulte totalement la possibilité que, dans le contexte de l’affrontement Nord-Sud hérité de la colonisation, la référence religieuse (islamique) « du Sud » puisse avoir un potentiel banalement identitaire, très différent de celui qu’a eu l’Église chrétienne au service de la monarchie absolue. Et elle homogénéise radicalement le très large spectre contemporain des expressions de l’islam politique, dont la représentation est figée dans le ciment d’un immobilisme essentialiste pourtant systématiquement démenti par n’importe quelle observation du terrain.
Car dans le nouveau rapport d’El Karoui, le rejet ne touche pas seulement les expressions extrêmes éminemment condamnables. Il englobe la moindre des affirmations de l’identité religieuse dans l’espace publique ou médiatique. Ainsi, la chanteuse Mennel Ibtissem et son inacceptable « foulard islamique » ou n’importe quel musulman respectueux des plus banales prescriptions (viande hallal notamment) – mais tout autant, il est vrai, l’auteur de ces lignes :-) – sont assimilés indistinctement, quelle que soit leur place sur l’échiquier politique, à des «agents d’influence de l’islamisme ».
Cette première thèse a sans trop de surprise la faveur des destinataires occidentaux du rapport de l’Institut Montaigne. Mais elle est également promue activement par une large partie des élites autoritaires du monde musulman.
L’origine de l’enthousiasme de ces deux catégories d’acteurs est évidente : la thèse de l’explication « toute idéologique » de l’islamisme présente l’avantage considérable de les exonérer de la moindre responsabilité dans les tensions qui, aussi bien sur la scène internationale que sur les scènes domestiques, traversent leurs sociétés. La responsabilité des déchirures du monde est ainsi confortablement renvoyée au passé proche ou lointain, d’Ibn Taymiya (1263-1328) à Sayyed Qutb (1906-1966) ou au petit nombre de penseurs qui, dans des configurations historiques internes ou internationales le plus souvent réactives, ont formalisé les appropriations politiques clivantes et sectaires du dogme musulman.
À l’abri des projecteurs des grands médias, une autre école tente – avec d’infinies difficultés – de démontrer, preuves à l’appui, que le rejet réactif qui prévaut majoritairement en Occident ne peut faire l’impasse sur deux réalités de terrain, pourtant massives. Premièrement, l’usage du lexique islamique en politique – par des formations dont la diversité va aujourd’hui de celle dirigée par le Tunisien modéré Rached Ghannouchi au « califat » de l’Irakien radical Abou Bakr al-Baghdadi – ne débouche pas exclusivement, bien au contraire, sur le radicalisme sociétal et politique de ses franges extrêmes.
Très majoritairement, comme le démontrent nombre d’expériences concrètes – pas seulement (pour autant qu’elles soient considérées autrement que par le prisme déformant de la presse occidentale) en Tunisie -, il s’accommode de plus en plus explicitement, aussi bien et souvent mieux que les « démocraties » laïco-éradicatrices à l’algérienne qu’affectionnent les Occidentaux, de l’essentiel des valeurs de la démocratie la plus universelle.
Deuxièmement, lorsque le lexique islamique ne sert à exprimer qu’une rupture sectaire radicale, comme cela est le cas de la mouvance de l’« État islamique », les causes de cette radicalisation ne relèvent pas simplement de l’usage de ce lexique: elles doivent également et très prioritairement être recherchées du côté de l’environnement social et politique où se produisent ces poussées extrémistes.
Et il est rappelé que cet environnement englobe les élites dirigeantes – notamment (mais pas seulement) occidentales – dans chacune des sociétés où voient le jour de telles radicalisations. Pour les tenants de cette seconde lecture, l’idéologie radicale est certes identifiée et le cas échéant clairement condamnée comme telle. Mais leur démarche de « lutte contre la radicalisation » ne s’arrête pas en chemin : elle s’emploie également à identifier avec rigueur les raisons qui, dans le large éventail des modes possibles d’appropriation du dogme musulman en politique, conduisent certains acteurs à choisir les plus binaires, clivants ou conflictuels.
Cette réalité complexe, néanmoins parfaitement accessible à tout observateur sérieux, échappe hélas! totalement à l’approche biaisée que le gouvernement français, avec un regrettable degré d’irresponsabilité – ou une regrettable fragilité devant les sirènes du populisme –, pourrait être une nouvelle fois en passe de cautionner en suivant les préconisations de l’auteur du nouveau rapport de l’Institut Montaigne.
Même s’il est loin en la matière d’être le seul, ce dernier ignore complètement un paradoxe essentiel des conditions de l’« insertion » heureuse et efficace des Français de culture musulmane : pour réduire la fracture qui tend à les séparer de leurs concitoyens, engendrant le mal-vivre d’une grande majorité d’entre eux et les conduites de rejet violent d’un tout petit nombre, c’est particulièrement ceux qui s’expriment sur le registre oppositionnel qu’il faudrait inviter à participer davantage au processus de prise de décision en matière de « gestion de l’islam de France ». Car ce sont justement ces voix-là qui font le plus défaut au concert citoyen et à l’alchimie de l’« intégration ».
Or, en réduisant comme peau de chagrin l’éventail social des musulmans « citoyennement légitimes », c’est dans la direction diamétralement opposée qu’El Karoui invite l’exécutif français à diriger le pays. Refermant ainsi derrière lui – et derrière le tout petit nombre des musulmans « élus» par la classe politique – la porte de l’ouverture citoyenne. En arrière toute ?
Notes
[1] Voir notamment le sociologue Vincent Geisser, qui explique : « La posture du rapport est une sorte de retour aux visions essentialistes du xixe siècle, à une époque où l’islam était d’ailleurs désigné par le terme islamisme comme dans la célèbre conférence d’Ernest Renan prononcée à la Sorbonne le 28 mars 1883. Mais le problème du rapport, c’est que nous ne sommes plus au xixe siècle mais au xxie siècle ! La relation entre islam et politique ne peut plus être pensée exclusivement à travers le prisme de l’islamisme » (« Le rapport Karoui vu par V. Geisser : “Le mot “islamisme” n’est plus forcément opératoire sur le plan scientifique” », Mizane.info, 19 septembre 2018).
Pour Fateh Kimouche, fondateur du site Al Kanz, il est très difficile de comprendre pourquoi, (sous prétexte que) « la France a été attaquée par des terroristes, il faudrait gérer l’islam de France… Quel est le lien?» Le second élément qui l’interpelle, « c’est l’ingérence. […] Je suis très prudent avec l’usage des termes comme “néocolonialiste”, mais là, pour le coup, on est véritablement dans une gestion indigéniste de l’islam. Emmanuel Macron s’inscrit dans la tradition française qui prévalait quand la France avait encore ses colonies » (« Islam : “Le rapport El Karoui relève d'une gestion indigéniste” », Le Point, 10 septembre 2018).
[2] « “Lutter contre l’islam” : le lapsus révélateur de Hakim El Karoui de l’Institut Montaigne », RTL, 10 septembre 2018.
[3] Voir sur ce point l’article éclairant de l’historienne italienne Anna Bozzo, « Islam et citoyenneté en Algérie sous la IIIe République : logiques d’émancipation et contradictions coloniales (exemple des lois de 1901 et 1905), in Pierre-Jean Luizard (dir.), Le Choc colonial et l’islam. Les politiques religieuses des puissances coloniales en terre d’islam, La Découverte, Paris, 2006.
[4] Mathieu Magnaudeix et Lénaïg Bredoux, « L’ex-plume de Raffarin a conseillé Ben Ali jusqu’au bout », Mediapart, 8 février 2011.