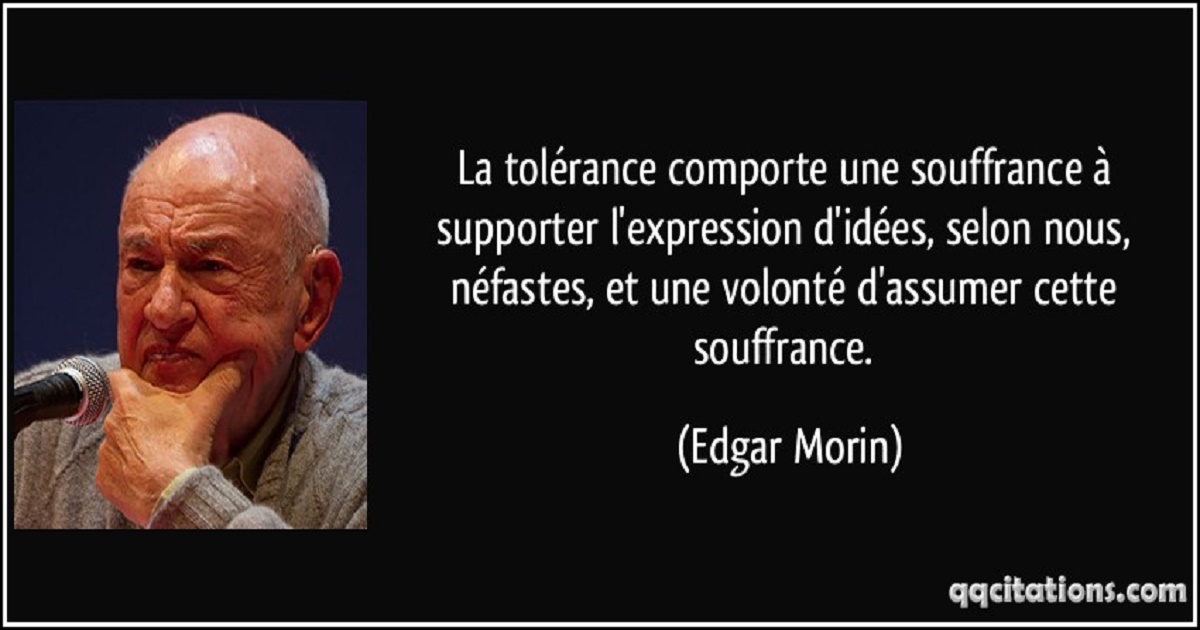
Mon père était le quatrième ou cinquième fils d’une douzaine qu’un mariage d’immigrants libanais, chrétienne elle et probablement lui aussi, a donné à l’Uruguay. Toute son enfance il l’a vécue dans la misère, en grattant les racines du champ pour manger, en mettant les pieds déchaussés dans le fumier des vaches pour amoindrir le froid des aubes givrées, se battant avec d’autres pauvres pour les os que le Frigorífico Tacuarembó rejetait.
Il était un enfant de l’école quand avec ses frères il travaillait déjà en pétrissant de la boue pour faire des briques ou en plantant des légumes qu’il vendait ensuite au village. Quand un frère revenait de l’école, l’autre le retrouvait à la sortie du village pour lui prendre ses chaussures.
Avec le temps, aux alentours des années cinquante, mon père a réussi à partir à la capitale pour étudier la menuiserie et la radiophonie et de retour dans son village il a ouvert son Usine de meubles, comme il la nommait, en plus de commencer diverses affaires et de fonder un Rotary Club et une coopérative bancaire avec une certaine réussite. Pendant le jour, il travaillait dans sa pharmacie ou cherchait une vache perdue dans un de ses champs et les nuits, pendant trente ans, il a donné des cours à l’école technique. Ses collègues riaient de son habileté à s’en dormir assis ou encore débout.
« Si je revenais vivre, je travaillerais moins et jouirais plus », c’était l’une des dernières choses qu’il m’a dite par téléphone, non par amertume mais pour me donner un nouveau conseil, qui s’est trouvé le dernier. Notre dernière conversation fut sur un ton de plaisanteries, parce qu’on ne sait jamais le signifiant de chaque moment.
Le jour suivant ses obsèques, en marchant par les recoins de la ville de mes vies précédentes, comme si je promenais la tristesse avec l’espoir secret qu’elle se perde dans un coin de rue, j’ai croisé de nombreuses personnes, trop nombreuses pour le moment, la majorité d’entre elles je ne les connaissais pas ou n’arrivais pas à les reconnaître après tant d’années. L’un d’eux m’a dit :
–La meilleure période de ma vie Je l’ai passé quand je travaillais avec ton père. L’homme savait comment obtenir du travail dans n’importe quelle ville et là-bas nous allions tous.
– J’ai été un élève de ton père – m’a dit un autre monsieur, de qui oui je me souvenais des années en arrière–. J’étais un garçon perdu quand je l’ai connu. Il m’a donné mon premier travail et il m’a appris à devenir quelqu’un. Si ce n’était pas grâce à lui, aujourd’hui je ne serais pas ce que je suis ni j’aurais la famille que j’ai.
Ma perspective, comme celle de n’importe qui, n’est pas neutre. Pour moi c’était un homme austère, généreux avec les siens et les autres, bien que plusieurs pensent sûrement le contraire. « Pour les uns je suis un type bien – disait-il – et pour d’autres sûrement un misérable. On ne peut pas être bien avec Dieu et avec le diable. » Il n’était pas difficile de lui trouver des défauts, non parce qu’il se distingue spécialement dans cette particularité humaine, mais parce qu’il n’est jamais difficile de trouver des défauts chez les autres. Si on dit même qu’il y a déjà eu un type parfait, qui passait tout son temps en prêchant de l’amour démocratique même à ses ennemis et ils l’ont crucifié quand même : Que peut-on attendre de plus ?
Ceci était encore plus évident dans le monde des passions idéologiques. Nous discutions toujours de politique. Lui, enferré dans ses convictions conservatrices et moi, enferré à les réfuter. Nos discussions étaient intenses, mais étaient toujours résolues d’une façon simple :
– Eh bien, je vois déjà que nous n’allons pas nous mettre d’accord – disait-il– ; allons prendre un vin, alors.
Certes, quelqu’un dira que la tolérance n’est pas le vin, mais l’opium des peuples. Il n’en est pas moins vrai que son absence est la mort des peuples et, pire, la frustration de chacune des vies concrètes qui façonnent cette abstraction mythologique.
Je l’aimais beaucoup, comme tout bon fils peut aimer un bon père. Mais un fils n’aime jamais autant comme un père. Cela prend toute une vie pour arriver à cette vérité ; même, certains ont besoin de deux pour le comprendre et une de plus pour arriver à l’accepter. Ainsi, on découvre dans les souvenirs anciens d’autres significations, de plus en plus profondes.
Par exemple, lors de plusieurs élections politiques le vieux a composé les listes de son parti. Je n’ai jamais voté pour lui. Je me rappelle que la première fois, à la fin des années 80, j’ai voté pour un naissant parti écologique. Quand je suis arrivé à la maison, j’ai dit à mon père que je n’avais pas voté pour lui. Comme toujours, il l’a reçu avec un sourire et il m’a dit que j’avais bien fait.
Maintenant qu’il est mort, je me demande à quoi diable a servi toute cette honnêteté idéaliste dont j’ai bénéficié ce jour d’élections. A quoi a servi toute cette petite cruauté ? A quoi a servi toute cette petite vérité, cette honnêteté suspecte ?
A quoi bon tout cela a servi ? Je me le demande tandis que je regarde un paquet d’une centaine de lettres écrites en arabe que ses parents ont écrit et ont reçu il y a presque un siècle. Je ne sais pas ce qu’ils disent. À peine si je peux soupçonner des histoires, des amours et de l’indifférence, des rencontres et des éloignements que mon père , non plus, n’est jamais arrivé à connaître parce que les siens lui ont aussi caché leurs frustrations, comme ils ont caché tous les secrets de la langue qu’ils utilisaient seulement dans le plus profond de leurs deux intimités dévastées dans un habitat en torchis, au milieu d’un champ qui n’était pas à lui et qui donnait à peine de quoi survivre.
A quoi bien a servi tout cela ?, je recommence à me demander.
Alors je regarde mon fils qui regarde à travers la fenêtre, comme j’avais l’habitude de regarder tandis que mon père travaillait dans des choses plus utiles et je me rends compte que je connais la réponse. La réponse, non la vérité. Parce qu’une chose est le devoir, ce qui doit être, et l’autre simplement ce qui est. Pour l’une il n’y a pas de doutes et pour l’autre, sur la vérité, probablement personne ne sait ni même son nom.
* Jorge Majfud. Auteur uruguayen et professeur de littérature latinoaméricaine à l’Université de Géorgie, Etats-Unis.