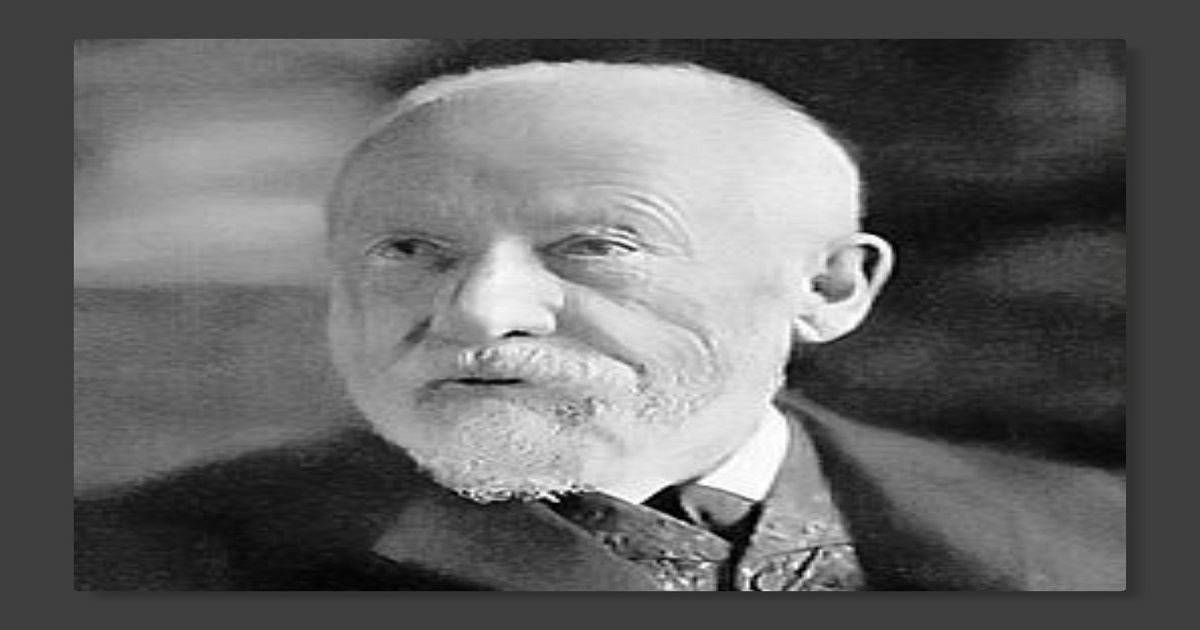
Qu’il s’agisse d’œuvres issues de la littérature sacrée ou de la littérature profane, l’herméneutique a longtemps été dédiée à la compréhension de textes. Avec Schleiermacher, cependant, nous voyons qu’un élargissement s’opère puisque, au-delà du texte, il s’agit de comprendre un acte de création, une intention qui se loge au cœur de l’auteur.
A la faveur de cet élargissement, le texte lui-même n’apparaît plus que comme le sédiment d’une parole vive qui le précède. Et l’histoire, de ce point de vue, n’est sollicitée que pour autant qu’elle soit en mesure de concourir à la compréhension de ce qui jaillit dans l’œuvre. Ou en tout cas qu’elle prémunit l’interprète contre tout risque de mécompréhension de cette « forme interne » qui préside à l’élaboration de l’œuvre.
Le moment va arriver cependant où l’histoire va devenir elle-même objet du travail herméneutique. Et ce sera le second moment de l’élargissement, que l’on doit, lui, à Wilhelm Dilthey. Comme le dira Hans-Georg Gadamer, un autre herméneute que nous aurons bientôt à aborder : « L’histoire du monde est en quelque sorte le grand livre obscur, l’ouvrage collectif de l’esprit humain rédigé dans les langues du passé et dont le texte doit être compris ».
Il faudra examiner d’ailleurs, en son temps, dans quelle mesure cette attention particulière à l’histoire elle-même s’affirme au bénéfice, ou alors au détriment, de la compréhension des œuvres qui nous viennent du passé.
Est-ce que l’herméneutique n’est pas ainsi en train de renoncer à sa vocation première, en s’engageant sur un terrain qui fut davantage celui de la philosophie de l’histoire ? Est-ce que cet engagement au service de l’élucidation de la question du sens de l’histoire ne vaut pas délaissement des œuvres qui jalonnent la vie spirituelle des hommes ?
C’est un fait cependant que l’herméneutique ne pouvait se maintenir en dehors des grands bouleversements qui ont marqué la pensée de l’histoire au cours du 19e siècle. D’autant que l’opinion était unanime concernant le fait que l’histoire n’est pas simple collecte et enregistrement de faits, mais qu’elle est aussi « interprétation ».
Sciences de l’esprit, sciences de la nature
La période pendant laquelle Dilthey apporte sa contribution au débat présente un certain nombre de caractéristiques, qu’il convient de préciser. Tout d’abord, après la phase du rayonnement, la conception hégélienne de l’histoire fait l’objet d’un vaste mouvement de rejet, en particulier de la part des historiens. Elle est perçue comme « spéculative » et en rupture avec la réalité des événements.
Elle prétend imposer un sens au devenir de l’humanité, disent-ils, mais elle se trouve désavouée par les développements de l’histoire que nous observons.
Ensuite, et à côté de ce rejet, il y a un positivisme historique qui voudrait peut-être combler le vide laissé par Hegel. Parmi ses représentants, citons le français Hippolyte Taine, qui revendiquait pour l’historien la possibilité de travailler comme un naturaliste, ou l’anglais Thomas Buckle.
Ce courant s’inspirait d’Auguste Comte et de Stuart Mill afin de soumettre l’histoire à la méthodologie qui était en vigueur en matière de connaissance de la nature. C’est le « monisme naturaliste » !
Enfin, le climat intellectuel général était celui d’une défiance à l’égard du subjectivisme. L’histoire elle-même était soupçonnée de permettre aux historiens de donner libre cours à l’expression de leurs lectures personnelles des événements du passé, tout en continuant de se prévaloir de la rigueur scientifique.
L’équation était donc la suivante : comment fonder une connaissance historique qui fût objective, tout en n’étant ni spéculative, ni engagée dans cette volonté de forcer l’histoire à se soumettre à l’ordre qui prévaut en matière de connaissance de la nature. Pour Dilthey, le fait que l’histoire nous mettait en présence de phénomènes signifiants, comme sont les mots dans un texte, justifiait que l’herméneutique soit mise à contribution pour résoudre pareille équation.
Il lui revenait d’appréhender le passé des hommes quant à la cohérence de son sens, et ce faisant de conférer à l’histoire comme discipline son caractère scientifique propre…
Il y a, d’une façon plus générale, des sciences de l’esprit, distinctes des sciences de la nature, et ces sciences de l’esprit s’appuient désormais sur une « méthode ». La réflexion sur la scientificité de l’histoire débouche chez Dilthey sur un projet plus ambitieux, qui consiste à réorganiser les sciences de l’esprit, qu’on appelle aussi sciences humaines.
La pratique moderne de l’histoire s’inscrit désormais dans le cadre de ce vaste projet de réaménagement, et c’est en outre à partir de cette position nouvelle qu’elle adresse ses objections à l’histoire théologique et ses conceptions eschatologiques du monde.
Il faut pourtant savoir que, dans cette œuvre de fondation de la méthodologie des sciences de l’esprit, Dilthey va se trouver en dialogue avec deux historiens en particulier, dont la réflexion sur l’équation que nous avons formulée ci-dessus avait permis de dégager des perspectives. Il s’agit de Ranke et de Droysen ! Faire connaissance avec leur pensée est du reste une bonne façon de se familiariser avec les arcanes d’un débat difficile dont les enjeux politiques ne furent pas négligeables.
Ranke et Droysen
Johann Gustav Droysen (1808-1884) s’est fait connaître par son Histoire d’Alexandre le Grand (1833), qu’il a fait suivre de divers textes rassemblés sous le titre d’Histoire de l’hellénisme (1833-1843). Nous lui devons d’ailleurs quelques développements sur la relation entre la Grèce et l’empire carthaginois.
Mais ce qui ne manque pas de frapper dès ses premiers écrits, c’est sa façon de prendre le contrepied de la position de ses pairs concernant le sens à donner à la période hellénistique : elle n’est pas pour lui déclin par rapport à la période classique des cités et de leur confédération, elle est au contraire moment d’élargissement et d’épanouissement. La preuve : tout le monde se met à parler la langue grecque autour de la Méditerranée.
Or ce renversement qu’il opère, il l’inscrit délibérément dans une position qui, selon lui, n’est pas séparable d’un engagement éthique et politique. En fait, il n’est même pas séparable de sa vision de l’Etat prussien et de son rêve d’unité allemande… Droysen revendique une lecture ancrée dans un engagement, seul moyen, pense-t-il, de révéler une « orientation » de l’histoire. Laquelle orientation assure le lien de continuité entre les événements. Bref, il n’existe pas, estime-t-il, de façon neutre de pratiquer le métier d’historien. L’investigation de ce dernier est toujours participation, et cette participation vaut donc partialité : inévitable partialité !
Dans sa Théorie de l’histoire, texte beaucoup plus tardif (1882), il revient sur ces considérations en faisant valoir qu’il n’est pas possible pour l’historien de s’isoler de ce dont il parle, de s’en extraire. En ce sens, l’exigence d’objectivité est à la fois illusoire et contreproductive. Pour autant, l’historien ne se laisse pas forcément abuser par ses choix, par ses solidarités éthiques.
Droysen critique l’apriorisme qui veut imposer de force un sens et une finalité à l’histoire.
Il en est d’ailleurs de même pour Leopold van Ranke (1795-1886), qui rappelle le devoir d’investigation continue de l’historien. Là où cesse l’investigation, l’histoire a fait acte de démission. Or il y a assurément une direction dont l’historien peut avoir l’intuition dans la façon dont les événements se succèdent sur la scène du monde, mais jamais un but final à partir duquel on pourrait résumer l’histoire comme en une équation résolue. De sorte qu’aucune expérience particulière, si inattendue fût-elle, ne devrait pouvoir venir ébranler la représentation que l’on se fait de la direction de l’histoire.
L’erreur d’un Marx, comme de tout partisan d’une conception trop hégélienne, est de vouloir résoudre l’équation : les événements se chargent alors de le démentir, et c’en est fini de son « système » !
Attitude épique ou médiation ?
La différence entre Ranke et Droysen réside dans leur conception de la force qui meut l’histoire. Car il y a une force sans laquelle la liberté des hommes cesse d’être effective. Ce qu’en langage moderne on exprimerait probablement en disant que la liberté doit « surfer » sur la nécessité de l’histoire : nécessité qui se manifeste quant à elle au travers de ce qui s’est déjà formé et qui est désormais irréversible dans la marche du monde.
Or, du point de vue de Ranke, la conscience de cette force relève d’un « pur abandon à l’intuition des choses », qui correspond à un « savoir divin ». Dans une lettre adressée à son frère Heinrich, Ranke parle encore de « l’attitude épique de celui qui cherche la fable de l’histoire du monde ». Mais il y a dans cette attitude épique une sorte d’effacement de soi qui permet de faire place à l’œil divin qui git en soi.
Pour Droysen, cependant, l’individu ne devient un acteur de l’histoire par sa liberté, ce qui signifie qu’il ne commence à incarner la force qui meut le monde, que dans la mesure où il prend part aux « solidarités éthiques », où il s’insère dans leurs mouvements… L’individu à lui seul n’est rien tant qu’il n’accède pas à la médiation de ces réalités éthiques en lesquelles se révèle le caractère de ce qui est constant et de ce qui est puissant. La force réside dans la médiation !
C’est donc essentiellement face à ces deux grandes figures de la pensée de l’histoire, et à travers leur opposition, que Dilthey va affirmer sa nouvelle épistémologie, telle que consignée dans un texte phare : la Critique de la raison historique. Un texte qui demeure par ailleurs une référence centrale dans le domaine de l’herméneutique moderne.