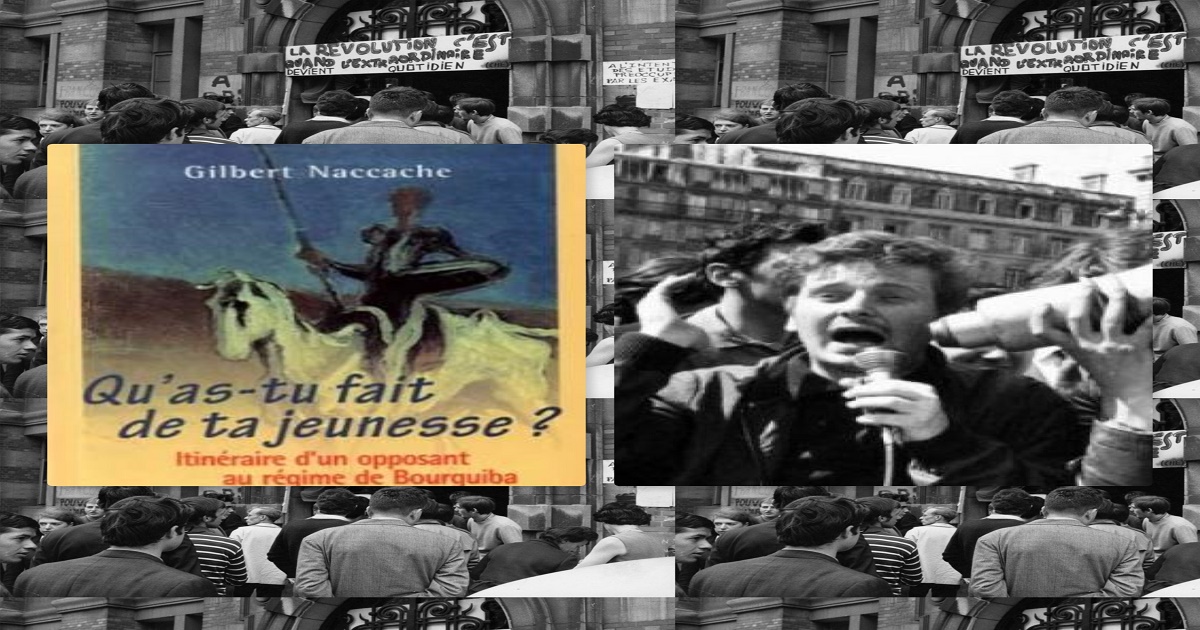
Pas plus que la plupart de mes contemporains, je n’avais vu venir les principaux événements des années 1968. Plus exactement, je vivais quelques-uns d’entre eux, sans parvenir à les situer dans un ensemble, à distinguer ce qui était une petite manifestation marginale de ce qui en était l’essence, encore moins pouvais-je discerner le caractère universel de la tempête qui allait nous entraîner.
Ainsi, par exemple, je n’avais guère sympathisé avec la mode des yé-yé, ce qui peut sembler naturel, mais je refusais aussi net le rock non anglo-saxon.
D’ailleurs, si j’avais dansé avec joie le rock’n roll, que je croyais, sans m’être posé sérieusement la question, une musique de noirs en continuité avec le jazz que j’aimais beaucoup, je n’avais guère de sympathie pour Elvis Presley et ne comprenais rien au phénomène rock.
Enfoncé dans les problèmes de haute politique, je ne percevais pas ce qui, dans la réalité d’alors, constituait les premiers symptômes d’un ultérieur tremblement de terre : ainsi, j’avais superbement ignoré la mode psychédélique et le phénomène hippie, qui aurait mérité davantage d’attention de la part de quelqu’un qui, à défaut de pouvoir immédiatement changer le monde, tentait en permanence de le comprendre : dans ce phénomène, je n’avais pas vu l’énorme part de révolte de ces jeunes des pays nantis qui criaient au monde leur refus des valeurs de leurs parents et essayaient de se fabriquer une identité nouvelle en rupture avec tout ce qui avait précédé ; j’avais aussi accueilli avec scepticisme les minijupes et souri avec une bienveillance un rien condescendante à ce qui me semblait une extravagance vestimentaire (1), sans voir que le féminisme allait partir également de la libération des corps, du rejet des pudeurs passées : sur ce point je restais un peu macho, comme le jeune homme qui avait été un peu choqué, quelque dix années plus tôt, quand les jupes étaient insolemment remontées au-dessus du genou.
Bien sûr, comme tous mes amis, je rejetais sans appel la drogue, sous toutes ses formes, y compris les joints, et n’avais que sarcasmes à l’égard des consommateurs de LSD et des adeptes de la révolution sexuelle de Willem Reich, qui me paraissait un gourou un peu charlatan, caressant les jeunes dans le sens du poil. Et surtout, chose que je ne comprends toujours pas aujourd’hui, je n’avais pas jugé utile de faire attention à Woodstock, le premier et énorme rassemblement des jeunes autour de la musique moderne.
Pourtant, j’aimais bien écouter les chanteurs de country américains, surtout ceux qui étaient engagés, comme Bob Dylan et Joan Baez, leur lutte contre la guerre du Vietnam nous les avait rendus proches.
Mais nous qui proclamions que les transformations à venir devaient se faire d’abord sur le plan culturel, nous avions du mal, comme la plupart des militants, à intégrer l’idée que les mobilisations de jeunes autour de la musique, qu’il s’agisse du rock avec des groupes comme les Beatles, que par ailleurs, on pouvait apprécier, ou d’autres genres, rythmés ou non, représentaient autre chose que le culte un peu idiot que de jeunes fils et filles à papa célébraient, faute d’idéaux politiques plus convaincants.
Je n’avais pas vu que, dans cette communion par les sens, en rupture avec tout ce qu’on leur avait inculqué, et avec ces autres jeunes plus sages du même âge, ces jeunes n’étaient pas très différents de nous, qui avions cette communion intellectuelle avec tous ceux qui luttaient pour les mêmes causes que nous, qui y trouvions la justification de notre nouvelle identité.
Cette incompréhension du rôle de la musique pour les jeunes me poursuivra encore quelque temps : après ma sortie de prison, en 1979, j’encourrai les foudres d’Isa, la fille de mon amie Paule, qui allait sur ses dix-sept ans, pour n’avoir « rien compris à La Fièvre du samedi soir (le film sur les jeunes et la musique)».
Nous, c’était davantage les luttes contre la guerre du Vietnam, l’évolution dans les pays de l’Est, la défaite future de l’impérialisme américain avec toutes les guerres de guérilla de l’Amérique latine, le castrisme, le guévarisme, la guerre au Proche-Orient, la libération de la Palestine et la Révolution culturelle chinoise qui nous interpellaient, en plus des problèmes tunisiens, et le dénominateur commun était la révolte contre l’ordre établi et les idées reçues.
Bref, nous vivions le même univers, vibrions aux mêmes stimuli, sous des formes diverses, et nous n’en savions rien. Mais en cela, nous n’étions pas différents des autres acteurs qui avaient fait 68, ils ne se doutaient pas plus que nous de l’ampleur du phénomène, ils n’ont sans doute pas encore élucidé tout son sens.
En prison, j’ai eu l’occasion de m’intéresser à ce mai 1968 en France auquel je n’avais pu – forcément, j’avais été arrêté avant – assister, encore moins participer, et dont je n’avais entendu parler qu’a posteriori ; j’ai lu tout ce qu’on nous avait envoyé sur le sujet. La plupart des écrits, reportages comme ouvrages d’analyse, avaient pour unique cadrage celui de la France pour y expliquer ce qui s’était passé.
Plus ou moins bons, ces ouvrages mettaient des aspects intéressants en valeur, mais aucun ne m’avait pleinement satisfait, aucun ne rendait véritablement compte du caractère universel, voire planétaire, du mouvement. Mon ami Karl Bach (je n’ai jamais su l’orthographe de son nom), rencontré en 1980 à Paris me fit remarquer qu’une des formes de la révolte de mai 1968, la barricade, était dans la continuité de la tradition parisienne du XIXème siècle en passant par le mouvement des pieds-noirs de mai 1958 à Alger (tiens, tiens !)(2) : s’ils n’avaient pas ramené grand-chose à leur retour précipité en France, ils n’étaient pas venus sans mémoire.
Ce n’est qu’en lisant, après 1980, un article de Jacques Bénac (un intellectuel plutôt anarchiste que Monique Laks(3) m’avait présenté) dans une revue libertaire que je commençai à sentir ce qui, dans la révolte des jeunes Français, était fondamental, commun à tous les mouvements du même genre dans le monde, en même temps sa principale force et sa faiblesse de base : le refus d’accepter que la civilisation soit fondée sur l’appropriation des richesses, la révolte contre la société de consommation et le désir d’être reconnu indépendamment de la richesse matérielle.
Et dans cette démarche était esquissée une vie différente, avec une véritable égalité entre les hommes et les femmes, avec une revendication nouvelle : être et non avoir et donc le refus de tout pouvoir, même le sien. La contradiction entre cette demande et l’impossibilité de changer les choses sans chercher ne serait-ce qu’une partie du pouvoir a rendu ce mouvement incapable de faire plus qu’une avancée, formidable mais insuffisante, dans l’utopie créatrice. Nous ne désirions nous-mêmes pas assez le pouvoir pour nous donner les moyens, même à terme, de le prendre, mais nous sentions (et le disions) que c’était la voie obligée, et par là nous avons fait peur, on nous a considérés comme des adversaires irréductibles et dangereux.
Au jour le jour nous sollicitaient divers problèmes, auxquels nous consacrions l’essentiel de nos énergies, nous trouvions tout de même le temps de vivre, de goûter à différentes joies. C’est sur ces problèmes que se déroulaient nos batailles, entre nous ou avec le pouvoir, nous n’avions aucune conscience que nous étions entraînés dans un tourbillon qui nous dépassait, qui nous fixait, sinon des objectifs, du moins une attitude, un état d’esprit qui avait besoin du support d’une idéologie.
Chez nous, cela avait été le maoïsme, nous étions aussi décidés dans la lutte que le furent dans la répression ceux qui n’avaient pas compris que le monde changeait, ou qui voulaient que les changements ne leur ôtent pas leur pouvoir, leurs privilèges, ce qu’ils croyaient être leur supériorité.
Notre combat était le signe que la société tunisienne qui se construisait ne voulait pas de l’autoritarisme, du mépris des gens, de l’arrogance des tenants du pouvoir, et tout cela était symbolisé dans le système coopératif, c’est ce système qui paierait en fin de compte le ras-le-bol de la société.
Notes
1.- Nos amies qui portaient des vêtements au-dessus du genou ne nous choquaient pas, on les aimait et les trouvait belles, mais elles ne s’étaient pas encore mises à la minijupe, ça prouvait bien que..
2.- Les barricades d’Alger de mai 1958, mouvement qui avait abouti au retour de de Gaulle au pouvoir en France, étaient loin d’avoir l’objectif libérateur qui sera celui de mai 68, puisqu’elles avaient pour objectif le maintien de la présence coloniale française en Algérie.
3.- Après leur départ de Tunisie en 1963 pour l’Algérie, mes amis Monique et Michel, qui n’avaient pas cessé de militer, firent partie des fameux pieds-rouges, arrêtés, torturés (Monique a même été violée) puis expulsés après le coup d’État de Boumediene en 1965. J’ai retrouvé Monique par la suite et nous sommes restés en contact jusqu’à sa mort, en 2000.