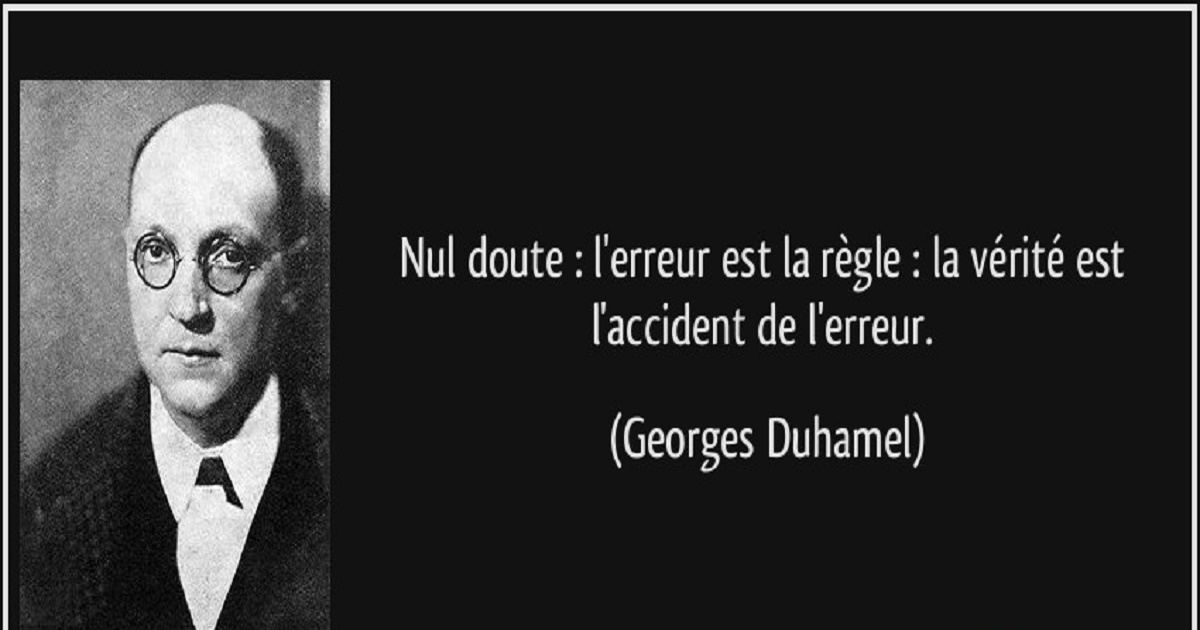
De la réalité à la vérité, il y a un jugement : telle chose est ainsi... Ainsi et pas autrement. Peut-être pourrions-nous ajouter à «jugement» le qualificatif «perspicace», «lucide»... Car, dans sa lecture de la réalité qui se donne à lui, l’esprit a toujours à compter avec le risque d’une illusion qui tromperait son jugement. Etre perspicace et lucide, c’est déjouer à l’avance un tel risque par une vigilance particulière. La vérité émerge dans l’épreuve du faux, auquel il est donc besoin qu’on prenne garde. En ce sens, celui que sa longue expérience des choses a rendu plus prudent est aussi plus capable de vérité, tandis que le naïf, lui, se laisse induire en erreur par l’apparence.
Mais de la vérité à la certitude, il y a l’épreuve du doute. Il se peut en effet que, malgré la vigilance, l’esprit soit quand même abusé. Il va donc lui falloir faire comme si le vrai était faux et montrer qu’une telle hypothèse est impossible. C’est à la condition de s’acquitter de cette hypothèse artificielle qu’on peut prétendre accéder à la certitude, c’est-à-dire à une vérité «certifiée».
La défaillance de la vigilance en matière de vérité ne relève pas d’un cas extraordinaire. Elle peut survenir pour plusieurs raisons. Il y a le cas où, parfois, l’expérience acquise ne suffit pas pour parer à l’illusion. Soit parce que la perception nous trahit dans des situations insolites, soit parce que notre façon d’utiliser le langage fait que nous affirmons plus que nous ne devrions et que nous sommes dupes de nos propositions: les mots se jouent de nous.
Mais il y a aussi le cas où l’illusion peut avoir été sciemment produite dans le but d’induire en erreur. La guerre est un terrain fertile par rapport à ce genre de situations : pour attirer l’ennemi dans un piège, on essaie de lui faire croire que le réel présente un visage particulier et, à partir de là, qu’il y aurait par exemple avantage à emprunter telle voie, à entreprendre telle action qu’on souhaiterait justement qu’il entreprenne... Car le stratège qui cherche à provoquer chez l’ennemi un jugement faux connaît assez la vigilance dont ce dernier est capable et, tout en la sollicitant, il va tenter de la leurrer. Sa cible, ce n’est pas notre naïveté qu’il cherche à abuser, c’est notre vigilance qu’il cherche à manœuvrer…
Et puis, il arrive que nous ayons intérêt à fausser la réalité, pour tromper des gens autour de nous qui nous font confiance dans le but d’obtenir d’eux quelque chose ou, également, pour nous tromper nous-mêmes quand le réel nous présente un visage trop insoutenable ou parce que nous sommes asservis par un secret désir qui nous travestit les choses. Il arrive qu’à tromper autrui, on finisse par se tromper soi-même. Il est même rare qu’en trompant autrui, on ne finisse pas par se tromper soi-même.
On est donc trompé soit parce que la puissance illusoire du réel est inhabituellement grande, soit parce qu’on décide soi-même, de façon plus ou moins délibérée, d’affaiblir sa vigilance ou de l’utiliser à contre-emploi, c’est-à-dire de tromper. De tromper au second degré, en réalité : non seulement en faisant passer le faux pour le vrai, mais aussi en faisant passer une telle tromperie pour un acte de sauvegarde de la vérité. Ce qui, en tout état de cause, a pour conséquence d’entraîner autrui dans le faux.
Le besoin de certitude assume donc cette possibilité de défaillance de la vigilance, mais aussi celle d’un désistement plus ou moins volontaire par rapport à l’engagement réciproque de vérité, voire d’une trahison de la confiance.
Bref, l’exigence de certitude refuse de s’en tenir au présupposé, ou de la supériorité de celui qui affirme le vrai face aux puissances diverses de l’illusion, ou de sa bonne foi face à la puissance de ses intérêts avoués ou inavoués. Ce qui lui confère une dimension plus qu’épistémologique, liée à la possibilité d’un discours scientifique : ce qui lui confère une dimension politique.
Mais comment s’acquitter de cette exigence ? Nous avons évoqué la semaine dernière le courant du scepticisme, dont la vocation est de pratiquer un doute systématique. Ce doute, disions-nous, bloque pour l’homme la possibilité d’un discours vrai : il faut se contenter du vraisemblable... Car, en définitive, qui peut garantir la «certification» de la certitude : qui peut la garantir contre une ultime mais décisive tentative de nous tromper ? Le fait qu’il y ait blocage pourrait signifier en tout cas que l’exigence de certitude est impossible à satisfaire. Il faut un minimum de confiance pour surmonter le doute, pour s’en libérer. On ne sort du doute que si, à un moment donné, on se résigne à le faire taire... Or comment peut-on le faire taire tout en continuant de revendiquer pour la vérité la nécessité de justifier ses prétentions ? Et, si on doit le faire taire, pourquoi à tel moment ?
Pourquoi pas plus tard, ou pas plus tôt ? Qu’est-ce qui décide que le doute est devenu «excessif» ? N’est-il pas dans sa nature de l’être toujours?
C’est certainement parce qu’il était conscient de cette difficulté que Platon a eu à cœur de concevoir une cité à l’intérieur de laquelle le discours vrai se trouverait mis à l’abri du risque de falsification. Il s’agirait de reconstituer les conditions sociales d’une solidarité humaine dans la préservation de la vérité...
Mais cette cité n’a pas vu le jour et Platon a eu des mots très amers et durs, dans un texte qui est une lettre - la «Lettre 7» - contre la façon dont la cité de son époque était gouvernée. Ce projet intervient à la suite de la condamnation du maître Socrate qui, pour ce qui le concerne, menait un travail à travers lequel la recherche de la vérité servait justement de réparation de la relation sociale du point de vue de cet engagement commun au vrai qui en est un fondement essentiel.
De son côté, Aristote va mener un travail consistant à systématiser la lutte contre le discours faux : contre les erreurs de la sophistique. Toutefois, à côté de cette dimension logique de son entreprise, il va instaurer le critère de l’expérience... C’est son fameux empirisme, qui jouera un rôle essentiel dans le développement des sciences de la nature. Or on note que, plusieurs siècles plus tard, la référence à Aristote aura la valeur d’une référence à un maître dans ce qui sera dénoncé comme un «argument d’autorité». Et c’est en particulier face à son enseignement que Descartes opposera son doute radical…
La solution aristotélicienne d’une vérité qui échappe au doute grâce à l’expérience recevra une réponse encore plus décisive lorsque Kant affirmera que les jugements «apodictiques» que nous produisons dans le domaine de l’expérience relèvent des «phénomènes»: leur «vérité» est tributaire des conditions de notre perception... Les choses elles-mêmes, nous n’y avons pas accès : elles nous échappent. De sorte que le monde au sujet duquel le discours scientifique prétend nous apporter une vérité n’est pas le monde : il est le monde de notre représentation.