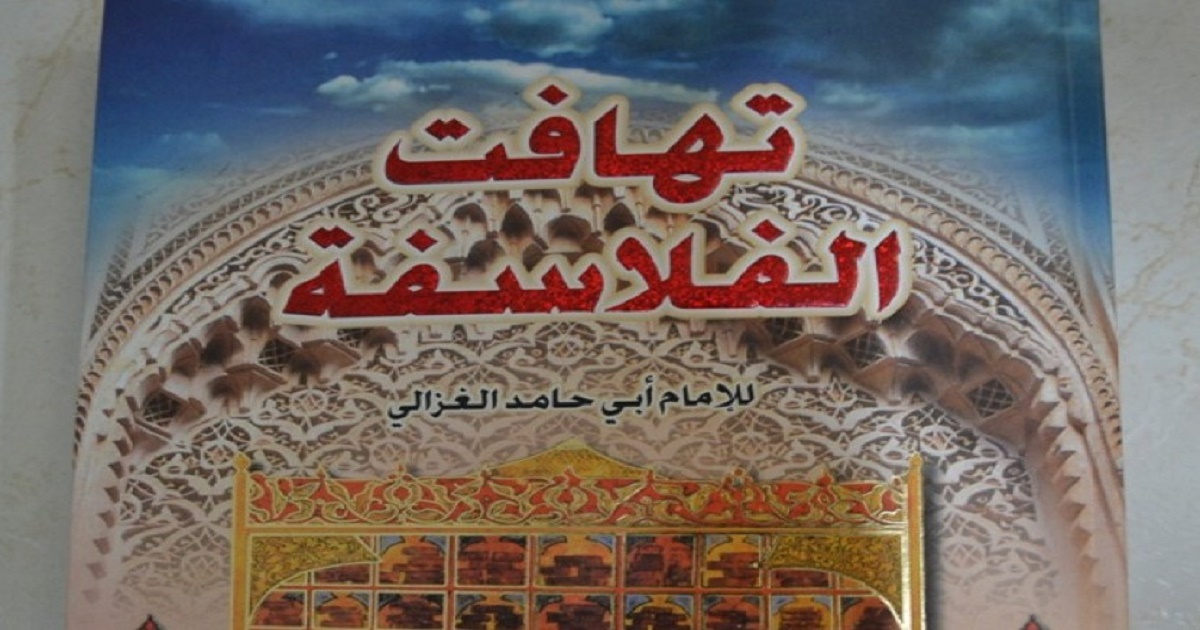
«La soif de connaître s’était glissée et infiltrée en moi à la fleur de l’âge; c’était comme une seconde nature que Dieu avait mise en moi sans qu’il y eût de ma part ni volonté ni effort. J’étais à peine sorti de l’enfance que j’avais déjà brisé les liens de la routine et que je m’étais affranchi des croyances héréditaires».
Ces quelques mots ont été écrits, ironie du sort, par un penseur musulman d’origine perse qui se fera connaître comme l’un des grands adversaires de la philosophie en terre d’islam et comme l’un des grands défenseurs de la foi. On les trouve dans un petit texte, fort accessible pour le non-initié, qui se présente comme une lettre où il répond à un jeune qui s’interroge sur la vérité... Ce texte, c’est le Munqidh mina’dhalel, qu’on traduit habituellement par le Préservatif de l’erreur. Son auteur est Abou Hamid el-Ghazali (1058-1111).
Ghazali a produit une littérature philosophique beaucoup plus difficile d’accès pour le lecteur d’aujourd’hui, à travers des ouvrages comme Maqasid el-falasifa (Intentions des philosophes) et Tahafut al-falalsifa (L’incohérence des philosophes). Mais c’est dans ce petit texte qu’est le Munqidh qu’on trouve résumée sa pensée et qu’on trouve aussi le passage où l’auteur évoque un épisode que les lecteurs de Descartes ne peuvent pas manquer d’associer à l’expérience du doute radical.
On notera cependant que le souci premier du penseur musulman n’est pas la certitude dans les sciences mais celle qu’on acquiert en religion face à la «confusion des sectes et la diversité des voies». Or Ghazali, contrairement aux pratiques d’usage parmi les théologiens, ne va pas chercher à mobiliser l’arsenal rationaliste de l’apologétique musulmane, il va... raconter son histoire. En commençant par cette soif de connaître qui se déclare chez lui dès son plus jeune âge. Et qui va le pousser petit à petit à explorer et à approfondir ses connaissances de toutes les doctrines prétendant offrir aux hommes la vérité.
C’est en cette option du récit autobiographique que réside peut-être la plus forte ressemblance entre le Munqidh et le Discours de la méthode.
Autre ressemblance, cependant : bien que le propos soit ici d’être fixé sur une vérité d’ordre religieux, le doute auquel va se soumettre Ghazali ne va pas épargner ses connaissances profanes. Il voit en effet que leur vérité est tributaire d’une certaine expérience et qu’il suffit qu’une expérience contraire survienne pour que tombe la vérité en question. Pas de certitude possible, par conséquent. Et pas de certitude de façon irréversible et définitive, contre le projet cartésien par rapport auquel l’expérience du doute vise, en fin de parcours, à rétablir justement la certitude dans les connaissances scientifiques, ou à fonder ces dernières sur des bases indubitables.
En quelques mots, Ghazali suggère à son lecteur que l’édifice de la connaissance scientifique hérité de l’empirisme aristotélicien est un édifice qui est à la merci d’une opération de doute. Et que toute la philosophie qui se réclame de l’autorité du philosophe grec ne vaut donc que pour autant qu’on veuille bien lui accorder son crédit avec bienveillance. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas prouver qu’aucune occurrence ne viendra dans l’avenir démentir ce que, jusqu’à présent, l’expérience m’a permis d’établir... Or la certitude, explique Ghazali, suppose que l’adhésion à la vérité demeure inchangée quoi qu’il arrive, même si... la pierre est changée en or et le bâton en serpent ! Il y a d’ailleurs chez Ghazali toute une théorie du miracle, dont il affirme que nous ne pouvons pas prouver qu’il est impossible, car ce à partir de quoi nous le jugerions impossible — la science — ne tire elle-même son autorité que de la répétition des occurrences de certains événements, ou de leurs conjonctions : comme le fait de rapprocher une flamme d’un morceau de coton et le fait que ce morceau de coton s’enflamme.
Or le miracle est précisément l’interruption de ces occurrences, ce qui a pour conséquence de ruiner l’autorité de ce qui prétend être une norme de la nature. Cette position aura d’ailleurs un avenir en Occident, en particulier avec le penseur écossais David Hume.
L’expérience du doute se poursuit en passant des connaissances acquises aux perceptions des sens ainsi qu’aux principes logiques. Pour régler son compte aux vérités issues des sens, Ghazali invoque l’exemple de l’ombre que l’on croit immobile et qui, en réalité, bouge, quoique de façon très lente, avec le mouvement du soleil dans le ciel. Ensuite, parvenant aux vérités logiques comme le fait qu’une chose ne peut être à la fois créée et éternelle, morte et vivante, impossible et nécessaire, le penseur musulman recourt à l’argument du rêve : l’adhésion qu’on accorde à ces vérités peut très bien être du même ordre que celle qu’on accorde aux vérités qui nous apparaissent dans le rêve, et dont on se rend compte au réveil qu’elles ne tenaient leur qualité de vérité que du fait qu’on était plongé dans le sommeil...
Bref, qui dit que nous ne sommes pas dans un autre état de sommeil, dont nous nous réveillerons un jour, et que ces vérités logiques ne nous imposent leur évidence que parce que nous n’en sommes pas encore sortis ? Ghazali suggère même à son lecteur que l’extase mystique pourrait constituer cet état d’éveil supérieur par rapport auquel notre état ordinaire serait une forme de sommeil.
En fait, l’argument du rêve jette le doute tout ensemble sur les vérités des sens et sur celles de la raison. Ghazali raconte à ce moment du récit que, pendant deux mois entiers, il n’a pas pu se sortir de cet état d’incertitude qu’il compare à une maladie. Ce qui l’en a sorti, ce qui l’a «guéri», ce ne sont pas des arguments, dit-il, mais... la lumière de Dieu !
On note donc la ressemblance, là encore, avec Descartes, puisque c’est l’irruption de Dieu qui apporte le dénouement au doute radical. Mais, sur fond de cette ressemblance, apparaissent plusieurs dissemblances. Nous en retenons deux. Premièrement, la démarche de Ghazali n’est pas augustinienne : il n’y a pas une descente dans les profondeurs de la solitude qui est en même temps une ascension vers les cimes de Dieu.
Nous avons montré la semaine dernière que Descartes emprunte cette voie augustinienne, celle de la transcendance au cœur de l’immanence. Or le doute débouche dans le cas présent sur un état d’abattement et de déréliction par rapport auquel l’apparition de Dieu joue comme un événement providentiel et provenant de l’extérieur. C’est Dieu qui agit, pas le sujet : il jette sa lumière dans le cœur de sa créature malade et celle-ci retrouve son sens de la vérité face aux choses et face aux principes de la raison.
Deuxièmement, Ghazali s’empresse ici de livrer une interprétation religieuse de cette expérience salvatrice de Dieu. «On demandait au Prophète, écrit-il, l’explication de ce passage du livre divin : «Dieu ouvre à la foi musulmane le cœur de celui qu’il veut diriger. » — « Il s’agit, répondit le Prophète, de la lumière que Dieu répand dans le cœur. »
Autrement dit, et si l’on en croit le Prophète lui-même, l’expérience de la lumière divine que l’homme abattu par le doute reçoit et par laquelle il guérit est précisément la «foi musulmane» telle qu’évoquée dans le Coran... La délivrance du doute redonne donc le sens de la vérité et, dans le même temps, ouvre l’accès à la communauté des hommes qui ont la foi musulmane en partage.
Notons que cette position tranche avec celle du penseur «batiniste», qui part de la croyance commune de la communauté pour s’engager sur la voie d’une jouissance solitaire ayant pour conséquence de vider la communauté de son énergie spirituelle. Et elle tranche aussi avec celle du théologien qui se fait de la foi musulmane une conception formaliste et «communautariste». Pour Ghazali, tout homme qui éprouve et reçoit la lumière de Dieu dans un moment de découragement est un homme qui est de «foi musulmane»...
Il s’autorise du texte sacré et de la lecture qu’en fait le Prophète lui-même pour consacrer cette conception universaliste. Sa défense de l’islam face aux autres croyances s’accompagne d’une définition de la foi qui n’exige pas d’autre condition d’accès que le découragement de l’homme qui cherche la vérité sans la trouver et qui, dans cet état, offre son cœur à l’assaut de la lumière divine.
Cette sorte d’ouverture à laquelle il ne semble pas que l’on ait fait beaucoup attention parmi les commentateurs ne manque pourtant pas de creuser à l’avance un fossé avec l’expérience cartésienne du doute. La différence ici est celle du projet lui-même.
Dans quelle mesure ces deux expériences s’acquittent-elles vraiment des exigences philosophiques du doute: nous le verrons prochainement.